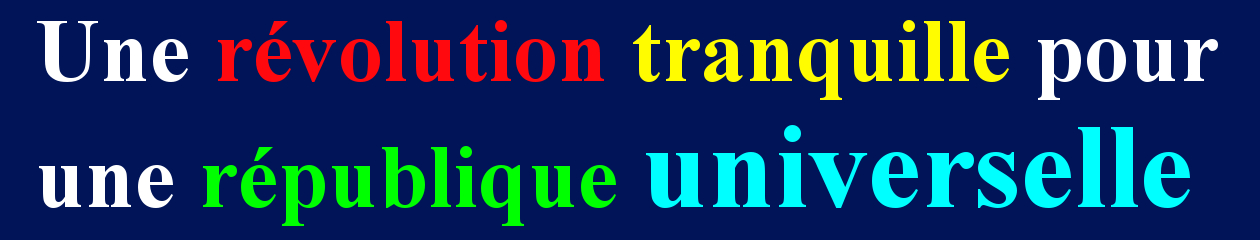Les gouvernements démocratiques se sont développés, certes par à coups, depuis les révolutions américaines et françaises de la fin du XVIIIème siècle, jusqu’à la fin du XXème siècle, depuis une vingtaine d’années, ce sont les dictatures qui sont en progression. Pour passer d’une dictature, ou de tout autre mouvement autocratique, à une démocratie, il faut une révolution. Mais pour repasser d’une démocratie, les solutions violentes d’un coup d’état ou d’une invasion ne sont pas les seules possibles…
En effet, le phénomène qu’on a constaté pour la fin de la république de Weimar, à savoir l’élection démocratique d’Adolf Hitler, un homme dont le programme affiché était de rompre avec la « molle » démocratie, purger le pays de ses ennemis de l’intérieur, reconquérir des territoires pour l’expansion de la race aryenne, cet exceptionnel avènement ne l’est plus.
En Afrique centrale, une démocratisation s’était profilée à l’horizon de plusieurs pays, à partir de 1989. Mais, sans doute guidés par la peur de l’instabilité, si meurtrière sur ce continent, les populations ont préféré les hommes forts déjà en place. Lorsqu’ils ont modifié la constitution pour pouvoir se représenter indéfiniment, ces chefs « rassurants » ont été plébiscités. Cela a été de même après les « printemps arabes », pour les pays qui n’ont pas sombré dans la guerre civile.
Les réélections successives de Vladimir Poutine depuis 2004 et 2008, avec l’intermède de l’homme de paille Medvedev, ont marqué chaque fois des régressions démocratiques pour la Russie, qu’on croyait libérée depuis 1989. Poutine a clairement utilisé plusieurs leviers :
- l’attrait des habitants d’un immense pays pour un homme fort qui évite le chaos, comme cela s’est passé plusieurs fois dans l’histoire
- le culte de la personnalité distillé par la propagande
- de faux attentats et la guerre de Tchétchénie, pour faire accepter un régime autoritaire, seul rempart à de tels dangers
- l’élimination physique des opposants, politiques ou journalistes
- le renforcement du nationalisme par les actions guerrières, la propagande la dénonciation des agents étrangers pour tous les problèmes
- La réécriture de l’histoire et de toute l’éducation pour la mettre au service d’un roman national
- la guerre d’Ukraine pour faire oublier le déclin économique et passer à une économie de guerre
Certains pays satellites, comme la Biélorussie, la Géorgie subissent cette influence néfaste. Mais d’autres pays d’Europe s’inspirent de ces exemples nationalistes, fascistes, nazis ou post-communistes : la Hongrie et l’Italie. Le nationalisme remonte dans tous les pays, même l’Allemagne dont il avait causé l’effondrement.
En Chine, la dictature s’est encore durcie avec l’élimination par Xi Jinping de ses concurrents qui partageaient le pouvoir avec lui. Mais cela nous éloigne de notre propos, il n’y a jamais eu d’élection au suffrage universel direct en Chine.
Car ce qui doit inquiéter le plus, c’est bien que des citoyens ayant pourtant reçu un minimum d’éducation, au moment crucial où ils peuvent exprimer leur avis sur le gouvernement de leur pays, choisissent l’injustice.
Or tous les êtres humains partagent ce sentiment, plus ou moins développé suivant leur intelligence, leur éducation, de ce que doit être la justice : une coutume, une règle, une loi, qui leur permette d’aspirer librement à leur part de bonheur dans le monde, en équilibre avec ces prochains. Malgré cela, consciemment ou non, un nombre de plus en plus grands d’individus choisissent le dirigeant le plus injuste, le plus cruel. La peur des représailles, l’espoir de faire partie des relatifs privilégiés et la haine de l’ennemi étranger identifié par l’autocrate se mêlent dans l’esprit de ces pauvres humains qui ruinent ainsi tout espoir de justice universelle.