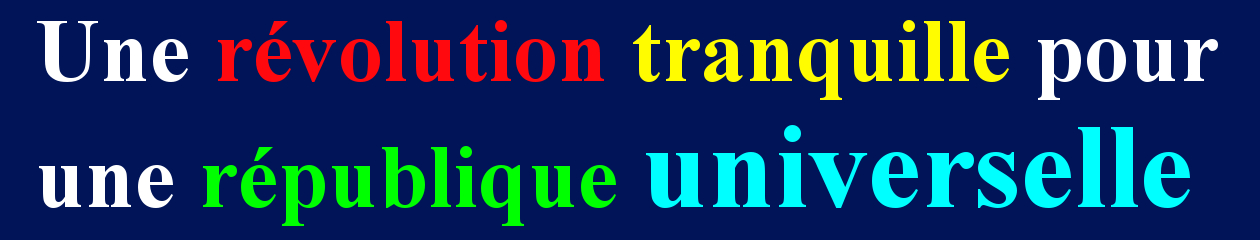En France, fin avril 2021, la justice vient de rendre une décision paradoxale. Un illuminé, islamiste, a tué une vieille dame parce qu’elle était juive. L’assassinat antisémite ne fait pas de doute, mais l’instruction s’est demandée pendant trois ans si l’assassin était responsable, car il était sous l’emprise du haschich. Tous les assassins ne le sont ils pas étymologiquement ? L’assassin a été considéré comme « coupable mais temporairement irresponsable », ce qui selon la loi française le dédouane d’une peine. Il sera néanmoins privé de liberté au sein d’un hôpital psychiatrique, mais la décision de « justice » sonne comme un appel au meurtre, un encouragement à toutes sortes d’excès.
En droit français, les « peines » ont plusieurs fonctions : punir le voleur, dissuader d’autres personnes de tenter les mêmes crimes et enfin protéger la société en isolant une personne dangereuse. Mais ces deux derniers objectifs sont complètement perdus de vue dans le fouillis inextricable de notre justice. Par contre, les juges appliquent scrupuleusement l’article de loi qui correspond au mieux au cas sur lequel ils doivent se prononcer, en oubliant l’esprit de la loi.
La fonction première des lois est de régler l’équilibre entre les libertés individuelles. C’est une fonction relative. Dans l’idéal, chaque cas devrait faire l’objet d’une réflexion profonde pour savoir quelle mesure devrait être prise vis à vis des personnes en cause pour qu’elles respectent davantage la liberté des autres. Pour limiter cette réflexion, les sociétés humaines ont édictés des commandements, des interdits, au départ assez limités puis de plus en plus en nombreux et stupides. Entre le « tu ne tueras point » biblique et l’interdiction d’acheter un vibromasseur dans l’Etat de Georgie, il y a une merveilleuse évolution…
Pourtant, même l’interdiction du meurtre est discutable et discutée. S’il s’agit de tuer son frère dont on est jaloux, le monde entier est d’accord pour condamner Caïn, même si Dieu ne lui inflige comme peine sur terre que son propre remords. Mais tuer quelqu’un qui cherche à vous tuer, cela semble beaucoup plus acceptable. Le droit français, pour les agressions entre individus, précise que la légitime défense doit être immédiate et proportionnée. Ces deux conditions sont les mêmes en droit international pour les conflits entre nations. Ces deux conditions, immédiateté et proportionnalité de la riposte à une attaque, méritent à chaque cas une appréciation et une interprétation.
Les lois ne sauraient se limiter à une application automatique d’une liste d’interdits. Le système pénal qui prétend être une justice absolue (à un interdit correspond une peine) n’est ni juste ni efficace. Pourquoi condamner plus durement quelqu’un qui a tué sa femme sur un coup de colère, qu’un élu de la république qui a été corrompu ou même qui a simplement menti à ses électeurs ? Et, dans l’actualité, pourquoi ne pas condamner un assassin, sous prétexte qu’il n’était plus maitre de lui au moment des faits ? Pourquoi laisser des personnes des politiques, des religieux, appeler à la haine, justifier des assassinats et des guerres ? Les personnes les plus dangereuses peuvent être laissées ou remises en liberté au bout d’un temps fixé arbitrairement, sans considération actualisée du risque.
Les lois doivent être complètement repensées, simplifiées pour en garder l’esprit et le but. En particulier, toutes les lois qui visent à éviter la violence, doivent entraîner une politique de prévention.
Cette prévention consiste d’abord à éduquer les enfants et expliquer à tous les citoyens qu’il doivent respecter la vie de leurs frères humains, mais aussi la vie sous toutes ses formes. Cette instruction doit s’accompagner d’une aide pour faire face aux difficultés matérielles qui poussent à la haine.
Le deuxième point de la prévention est d’empêcher la propagation des discours haineux, appelant au mépris d’une catégorie d’humains et justifiant des actes de violence. Cela nécessite un premier niveau de répression vis à vis des personnes ou des groupes qui nient l’égalité des êtres humains. Cette répression est subordonnée à l’objectif de prévention, et est limitée à la suppression du trouble (fermeture d’une salle de réunion, interdiction d’une publication, dissolution d’une association).
Le troisième point vise à limiter la liberté des individus qui sont susceptibles de commettre un acte de violence. Le fait d’avoir commis un acte criminel est une présomption, qui doit pousser la société à prendre des mesures fortes pour prévenir une récidive. Il s’agit d’une répression à but préventif et non punitif. On ne punit pas un homme pour son passé on limite sa liberté pour l’avenir. Cette limite doit être proportionnée au risque : surveillance, emprisonnement… Si un assassin doit être mis en prison ce n’est pas pour le crime qu’il a commis mais pour celui qu’il pourrait commettre. Pour que la privation de liberté soit limitée au minimum, la surveillance et l’emprisonnement doivent se doubler de mesures éducatives, permettant une éventuelle réinsertion.
La répression judiciaire est une légitime défense et doit suivre la même logique. La peine de mort est envisageable si c’est la seule méthode pour éviter la récidive, dans une société désorganisée par la guerre, ou dans l’urgence de l’action : un policier qui défend les victimes d’une aggression peut tirer sur l’aggresseur armé. Une société capable d’emprisonner aussi longtemps qu’il le faudra quelqu’un de dangereux n’a pas à le supprimer.
Dans ce nouvel esprit, l’assassin de Sarah Halimi aurait du être repéré avant l’assassinat pour les opinions qu’ils professait librement. Avec les fanatiques religieux qui l’ont influencé, il aurait du être soumis à de premières mesures de privations de liberté. Si malgré tout, on n’avait pas pu empêcher le crime, on aurait du le mettre en prison pour tout le temps qu’aurait duré sa vraie folie, qui était l’antisémitisme.
Les plus grands criminels de l’histoire, Napoléon, Hitler, Mao, Staline, Pol Pot, responsables de millions de morts, étaient indiscutablement fous, mégalomanes et paranoïaques. Il aurait bien fallu les juger, les condamner, les emprisonner, peut être même les tuer, pour les empêcher de nuire.
Considérer les fous comme toujours irresponsables est une erreur fondamentale. Le crime d’un fou, sous l’emprise d’une drogue ou de l’alcool, ou simplement de la colère ou de la passion, n’est pas moins grave que celui d’une personne ayant tout calculé froidement. Un fou n’est irresponsable que lorsque cette absence de maîtrise de soi a déjà été constatée et prise en compte par la société. Toute personne considérée comme un citoyen, et agissant en toute liberté, est responsable de ses actes. On n’est irresponsable que si quelqu’un d’autre assume la responsabilité de vos actes : les parents des enfants, les tuteurs d’un vieillard sénile, les surveillants d’une personne considérée comme dangereuse.